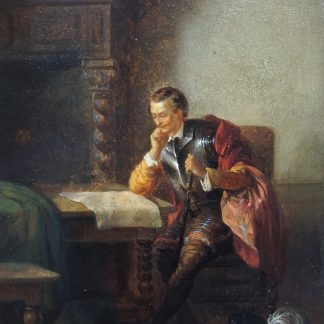Description
Joseph Théodore Coosemans (1828 – 1904)
Anvers-Bruxelles, École belge
Joseph Théodore Coosemans est un peintre de paysages autodidacte, auparavant clerc de notaire, secrétaire communal et receveur du bureau de bienfaisance de Tervueren (De Taeye 1894 : 444). Il entreprend également la direction des messageries publiques de Bruxelles à Tervueren (De Taeye 1894: 444). Avec cette dernière fonction, il rencontre quelques rares artistes qui venaient étudier le paysage au milieu des champs. Après une première rencontre avec Tschagenny, il se lie d’amitié avec le peintre Théodore Fourmois qui l’incite à se lancer dans le métier de peintre (De Taeye 1894: 445-6). Dès lors, il travaille dans la forêt de Soignes. Il fait la connaissance d’Alfred Verwee et divers peintres qui se donnaient rendez-vous à Tervueren (De Taeye 1894 : 446). Il expose pour la première fois en 1863. En 1864, il rencontre Hyppolite Boulenger qui l’influencera dans son œuvre (Revue Générale 1887: 775). Il est l’un des membres fondateurs en 1868 de la Société Libre des Beaux-Arts (Laoureux 2013 :112).
Il voyage en Normandie en 1872 en compagnie de Verwee et Dubois, peint en 1875 à Barbizon. Il reçoit des médailles à Vienne en 1873, à Londres en 1874, à Bruxelles en 1875 (Lamarre 1878: 180).
Il s’installe en 1876 à Louvain, il peint à Genk, en Campine. En 1887, il devient professeur puis directeur de l’Institut supérieur des Beaux-arts d’Anvers. À partir de 1893, partiellement paralysé, il réduit son activité. En 1905, une exposition rétrospective est organisée par le Cercle artistique et littéraire de Bruxelles (Tardieu 1905). Il a été nommé Officier de l’Ordre de Léopold (De Taeye 1894 : 444).
Les paysages de sous-bois se retrouvent fréquemment représentés dans l’œuvre de Coosemans. Étant habitué au paysage de Tervueren, il est très probable que notre peinture ait été réalisée là aussi. On retrouve notamment ce genre de chemin creux dans les tableaux représentant le chemin des Loups à Tervueren. Cette dernière ville est un lieu important de l’histoire de l’art belge. En effet, dès 1840, plusieurs artistes y sont présents, notamment Paul Lauters, Edmond de Schampeleer, Théodore Fourmois. Ces artistes assouvis d’un besoin de nature sont rejoints en 1864 par le peintre Hyppolite Boulenger (Revue Générale 1887: 775). Ce dernier y a été introduit par le peintre Camille Van Camp qui revenait il y a peu de Barbizon et avec lequel il partageait les mêmes idées sur la peinture (Revue Générale 1887: 775). Une véritable colonie d’artistes s’est alors formée autour de la figure d’Hyppolite Boulenger, tous enthousiastes, inspirés par la nature et désireux de rompre avec l’enseignement académique. Ils suivent le mouvement de l’École de Barbizon au point que l’expression « Barbizon belge » fut utilisée par les critiques du XIXe siècle pour désigner ce groupe de peintre (Gilles 2016). C’est dans ce contexte que l’on connait « l’École de Tervuren [1]».
Dans notre peinture, les couleurs sont automnales avec une majorité de brun-rouge et de vert. La composition est centrale avec des arbres de part et d’autre d’un chemin. Une percée entre les arbres laisse apparaitre un ciel bleu surplombé d’un nuage blanc.
[1] Le terme d’ « école de Tervuren » serait apparu en 1866. Le catalogue de l’Exposition générale des Beaux-Arts de Bruxelles stipulait dans son règlement que les artistes participants devaient inscrire le nom de leurs Maîtres, de l’Académie dans laquelle ils ont fait leurs études. Jules Raeymaekers aurait lancé l’idée à ses condisciples de se proclament de l’ « Ecole de Tervuren » (De Taeye 1894: 448). Il apparait toutefois que les artistes de Tervueren n’ont pas usé de ce terme pour affirmer un quelconque regroupement d’artiste ou mouvement (Gilles 2016).